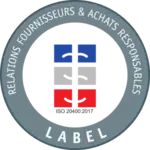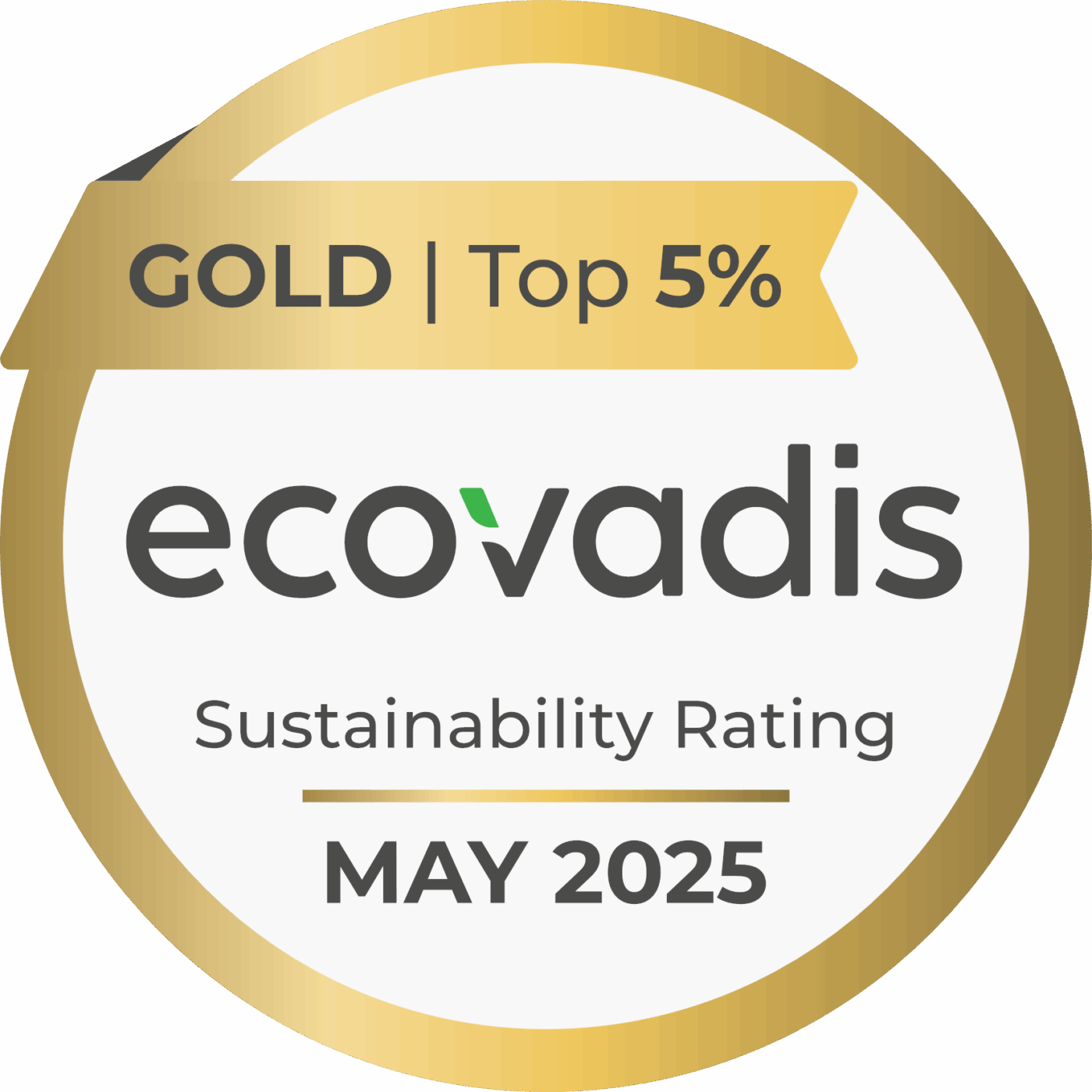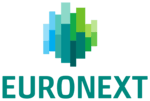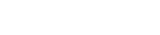Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit d’alourdir la taxe payée par les entreprises lors des ruptures conventionnelles. Une décision qui pourrait bouleverser les relations entre salariés et employeurs. En effet, le gouvernement entend freiner le recours aux ruptures conventionnelles.
Cet article est l’occasion de revenir sur ce projet de loi et d’étudier les conséquences que cela pourrait avoir sur les salariés.
Aujourd’hui, lorsqu’un employeur signe une rupture conventionnelle, il verse à l’Urssaf une contribution équivalente à 30 % de l’indemnité de départ du salarié. L’exécutif souhaite porter ce taux à 40 %. L’idée : limiter le nombre de ruptures conventionnelles tout en augmentant les recettes destinées à la Sécurité sociale.
Présentée à la mi-octobre, cette mesure s’inscrit dans la volonté de l’État de rendre le dispositif moins attractif pour les entreprises. Depuis sa création en 2008, la rupture conventionnelle est devenue un mode de séparation très utilisé, apprécié pour sa simplicité et son cadre légal clair.
D’après les estimations du gouvernement, les allocations chômage versées à la suite de ruptures conventionnelles représentent près de 10 milliards d’euros par an. Une somme jugée excessive par les pouvoirs publics, qui estiment que le dispositif est parfois détourné de son objectif initial.
L’ancienne ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, avait déjà dénoncé l’été dernier des « abus » dans l’usage de cette procédure. En 2024, plus de 514 000 ruptures conventionnelles ont été signées selon la Dares, un record qui renforce la volonté du gouvernement de durcir les règles.
Pour les spécialistes du droit du travail, ce renchérissement pourrait avoir des effets inattendus. Selon les spécialistes, en augmentant le coût pour l’employeur, on risque de réduire le nombre d’accords amiables, alors que la rupture conventionnelle a permis d’éviter de nombreux conflits.
Introduit sous le gouvernement Fillon, ce mécanisme avait précisément été conçu pour limiter les litiges et offrir une sortie équilibrée entre démission et licenciement. Le rendre plus cher pourrait déstabiliser cette mécanique.
Le gouvernement espère tirer 260 millions d’euros de recettes supplémentaires chaque année grâce à cette hausse. Un calcul que plusieurs juristes jugent optimiste. Si les entreprises limitent les ruptures conventionnelles, les entrées fiscales pourraient ne pas compenser la baisse du nombre de dossiers.
De plus, il reste à évaluer aujourd’hui combien de rupture conventionnelle remplace des démissions. Si beaucoup de salariés profitent de ce système pour accéder au chômage, d’autres l’utilisent simplement pour négocier un départ serein. Dans ce cas, le gain pour l’État pourrait être bien moindre qu’annoncé.
En alourdissant la taxe, le gouvernement pourrait aussi encourager des pratiques que la rupture conventionnelle avait justement fait reculer. Avant 2008, certains employeurs et salariés concluaient des accords officieux autour de licenciements arrangés.
Ces contournements, difficiles à contrôler, risquent de revenir sur le devant de la scène. Et avec eux, les litiges que la rupture conventionnelle avait largement contribué à réduire.
Cette hausse de contribution s’inscrit dans un contexte de rigueur budgétaire et de volonté de maîtrise des dépenses publiques. Mais en cherchant à freiner un dispositif devenu central dans la gestion des ressources humaines, le gouvernement pourrait relancer des tensions entre employeurs et salariés.
Entre souci d’équilibre financier et maintien d’un climat social apaisé, la réforme des ruptures conventionnelles s’annonce comme un test délicat pour l’exécutif. Les débats parlementaires à venir diront si cette nouvelle taxe sera réellement adoptée — et si elle tiendra ses promesses sans désorganiser le marché du travail.
OpenWork
Nous connaître
Actualité
RSE
Recrutement
Légal
Mentions légales
Politique de Confidentialité
Accessibilité numérique
Ressources
Portage salarial
Simulateur portage salarial
Calcul du TJM portage salarial
Cooptation
Métiers
Informatique
Formateurs et coachs
Consultants
Managers de transition